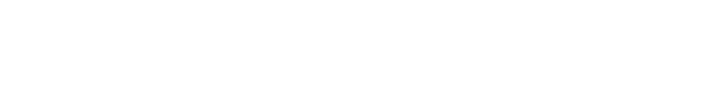Dans le cadre de sa vision du “rêve chinois”, le président Xi Jinping aspire au “renouveau du peuple chinois” et met ainsi l’accent sur l’utilisation du soft power, favorisant la diffusion de la culture chinoise à travers le monde. Cette orientation contraste avec les années Deng Xiaoping, une période durant laquelle la Chine avait principalement focalisé ses ressources culturelles sur la propagande domestique, s’effaçant volontairement de la scène internationale afin de nourrir davantage son développement économique interne. Alors que Deng Xiaoping prônait une diplomatie du “profil bas”, résumé par la formule : “cacher ses talents pour attendre son heure”, l’arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 a marqué l’émergence d’une rhétorique diamétralement opposée. Les diplomates sont désormais appelés à “bien raconter l’histoire de la Chine” à l’étranger, en harmonie avec le rêve chinois. L’objectif primaire étant de promouvoir la vision du monde du parti afin de contrer l’influence d’une vision occidentale dominante, tout en critiquant la démocratie libérale et l’universalisme. Ainsi, le mandat de Xi Jinping a inauguré une ère de renouveau pour l’impérialisme culturel chinois, caractérisée par l’adoption de nouvelles stratégies de soft power.
Défini comme la capacité d’influencer les préférences d’autrui par l’attrait de ses valeurs, de sa culture et de ses politiques, le soft power se distingue du hard power, qui cherche à obtenir des résultats par la coercition ou l’incitation, souvent à travers la force militaire ou économique. Le soft power repose sur la persuasion et est fortement dépendant de la réputation de l’acteur au sein de la communauté internationale. Il se manifeste par l’usage d’instruments classiques de la communication politique tels que les médias, la langue, l’art et la culture populaire, qui deviennent alors des vecteurs d’influence cruciaux.
La stratégie du soft power, élevant la richesse linguistique et culturelle au rang d’arme politique au service de États, s’inspire de stratégies anciennes. Par exemple, la création des Alliance Françaises remonte à la IIIe république, tandis que les Instituts Français ont été fondés en 1907. Ces institutions ont servi de modèle sur lequel se sont construits d’autres instituts linguistico-culturels nationaux d’envergure mondiale, tels que les British Councils pour le Royaume-Uni, les Instituts Goethe pour l’Allemagne, les Instituts Cervantes pour l’Espagne, ainsi que, plus récemment, les Instituts Confucius pour la Chine. Ces instituts culturels partagent plusieurs points communs : ils ont tous établi des antennes dans différents pays du monde avec pour but d’offrir la possibilité d’étudier leur langue et leur culture. Ils se distinguent cependant par des caractéristiques qui leur sont propres, comme des statuts différents. Par exemple, le British Council est une organisation caritative indépendante alignée sur la politique gouvernementale; alors que les Instituts Confucius sont une initiative gouvernementale financée par le parti et des partenariats locaux.
Il existe différentes approches au soft power selon les pays. En chinois, trois termes distincts désignent le soft power. Le plus couramment utilisé, et le plus proche de la définition occidentale, est “ruan shili”, se traduisant littéralement par “force douce”. Ce terme suggère non seulement une capacité d’influence, mais aussi la possession des moyens nécessaires pour exercer cette force. Néanmoins, certains auteurs emploient également les expressions “ruan quanli”, signifiant le pouvoir ou le droit d’agir, et “ruan liliang”, faisant référence à la force physique. Selon Nashidil Rouiaï, docteure en géographie au Centre National de la Recherche Scientifique français, les Instituts Confucius représentent la manifestation la plus visible du soft power chinois.
Par conséquent, elle déduit que: “le calcul des dirigeants est simple : plus les populations du monde maîtriseront la langue chinoise et s’intéresseront à la culture du pays, mieux seront comprises l’émergence de la Chine ainsi que les politiques et les idées véhiculées par l’Empire du Milieu sur la scène internationale”. Cette stratégie explique le développement rapide des Instituts Confucius à travers le monde depuis les années 2000.
Le premier Institut Confucius a été inauguré en 2004 à Séoul, en Corée du Sud, marquant un tournant significatif pour la Chine, qui s’alignait ainsi sur les grandes puissances occidentales après une période de semi-colonialisme. Bien qu’un projet pilote ait été lancé à Tachkent, en Ouzbékistan, c’est la Corée qui a été officiellement reconnue comme le berceau du premier institut. Les Instituts Confucius, malgré leur appellation, ne se consacrent pas principalement à l’enseignement de la philosophie de Confucius ; leur objectif est plutôt de promouvoir la langue et la culture chinoises à l’international. Ils proposent des cours de langue, ainsi que des ateliers de cuisine, de tai-chi, de kung fu, de calligraphie et d’initiation à la cérémonie du thé. Ces instituts jouent également un rôle en formant des consultants pour les entreprises et les organisations locales désireuses de commercer en Chine.
La plupart des instituts sont souvent le fruit de partenariats entre une institution académique chinoise et une institution étrangère. Ils sont principalement financés par Le Hanban (abréviation de Guojia Hanyu Guoji Tuiguang Lingdao Xiaozu Bangongshi), une organisation publique non lucrative affiliée au Ministère de l’Éducation. La majorité se trouvent sur des campus universitaires, comme à la Japan Sapporo University, résultant d’un partenariat avec la Guangdong University of Foreign Studies. Bien que tous les instituts partagent de nombreuses similarités, leurs spécificités propres varient considérablement. Par exemple, l’Institut Confucius de la London School of Economics a une orientation commerciale explicite, tandis que celui de la Waseda University est focalisé sur la recherche.
Cette initiative du gouvernement chinois s’est développée à un rythme fulgurant, reflétant ainsi la croissance de l’influence de la Chine sur la scène internationale. Entre 2012 et 2017, l’Institut Confucius s’est implanté dans 34 nouveaux pays, en ouvrant 116 nouveaux Instituts Confucius et en implantant 541 nouvelles classes Confucius dans des écoles primaires et secondaires. Selon un recensement réalisé en janvier 2019 par le Hanban, les Instituts Confucius sont désormais présents dans 154 pays à travers le monde, totalisant 548 Instituts et 1193 Classes Confucius. Ces institutions emploient 47 000 enseignants, chinois et étrangers, qui dispensent des cours de mandarin à environ 2,67 millions d’étudiants, dont 810 000 suivent des cours en ligne.
Il est toutefois essentiel de souligner que ce projet a également déclenché la foudre de nombreux détracteurs. Certains s’inquiètent de la pression que la Chine pourrait exercer sur l’enseignement et la recherche à l’etranger. Par exemple, les Instituts Confucius enseignent seulement les caractères chinois simplifiés, ceux utilisés sur le continent, et non pas les caractères chinois classiques employés par Taïwan. En outre, un membre du Parlement suédois a interrogé les priorités de Pékin en matière de subventions pour l’éducation d’éducation internationale, tandis que des millions d’enfants en Chine manquent d’écoles adéquates, une préoccupation exacerbée par le séisme de 2008 au Sichuan, où de nombreux établissement scolaires mal construits se sont effondrés, causant la mort de nombreux enfants.
Enfin, les Instituts Confucius sont également accusés d’espionnage. En 2019, la Belgique a privé de visa le directeur chinois de l’institut associé à la VUB, une université bruxelloise. Ce directeur était dans le collimateur de la Sûreté de l’État pour “atteinte à la sécurité nationale”. François-Yves Damon, sinologue et directeur de recherche au Centre français de recherche sur le renseignement, considère ces soupçons logiques. Il rappelle que, “en vertu de l’article 7 de la loi sur l’espionnage de juin 2017, tout ressortissant ou entreprise chinois est tenu d’apporter son soutien aux organismes de renseignement”. Bien que tout le monde ne soit pas un potentiel espion, il conclut : “les instituts Confucius seraient plutôt là (…) pour faire du contrôle, pour s’assurer que ce qui est véhiculé sur la Chine correspond à la volonté du Parti communiste, de l’État chinois”.
Ainsi, le déploiement des Instituts Confucius illustre à merveille la stratégie de soft power chinois, visant à accroître son influence internationale par la promotion de sa langue et de sa culture. Cependant, ce projet est également sujet à des critiques récurrentes concernant ses motivations politiques sous-jacentes. On peut donc se demander quel sera l’avenir de ces instituts : vont-ils être réformés en réponse à ces critiques ou continueront-ils d’accroître leur influence?
À mesure que les réalités géopolitiques évoluent et que les relations entre la Chine et l’Occident deviennent de plus en plus tendues, l’Occident continuera probablement à surveiller, examiner, évaluer et potentiellement restreindre les initiatives chinoises, y compris les instituts Confucius. Par conséquent, les efforts de la Chine pour étendre son soft power pourraient se tourner de plus en plus vers des régions où les populations locales sont davantage réceptives à son discours et où les gouvernements privilégient les gains économiques aux préoccupations sécuritaires, comme en Afrique ou en Asie du Sud Est. Effectivement, pour de nombreux pays en développement, l’apprentissage de la langue et de la culture chinoises est considéré comme une voie vers la croissance économique. La Chine est ainsi perçue comme un modèle de réussite, en dépit de sa gouvernance non démocratique.
Édité par Sofia Germanos.