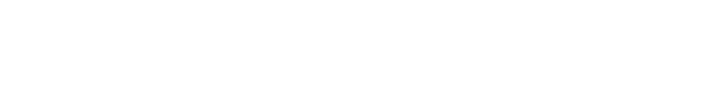L’Homme de Tian’anmen se tenant devant les chars chinois, l’immolation du moine Thich Quang Duc sur la place de Saigon, le corps du petit Aylan Kurdi échoué sur une plage turque… Des clichés iconiques qui ont fait la une des plus grands journaux, inondent nos manuels d’histoire et sont le parfait exemple du proverbe « une image vaut mille mots ». La capture réussie avec une caméra d’un moment fort de notre époque permet aux photojournalistes de véhiculer de puissants messages et de marquer davantage les esprits qu’un article journalistique conventionnel.
À en voir les gagnants du prix Pulitzer, le succès de ces clichés est bien souvent corrélé aux vives émotions qu’ils inspirent. Plus une photo est choquante, plus elle interroge et plus ses impacts sont importants. Se pose alors la question de l’éthique : de quelle légitimité disposent les photojournalistes pour diffuser les maux d’autrui?
Précisons pour commencer que cela n’est pas anodin si, chaque année, des journalistes se rendent dans les zones à risques pour reporter ce qu’il s’y passe. Ils sont à la recherche de cette arme inestimable dont la possession peut faire basculer dramatiquement les événements: l’information. La mission audacieuse des journalistes est de mettre en lumière ce que les pouvoirs entendent cacher : actes injustes, décisions illégales, criminelles, antidémocratiques, qui nécessitent l’attention nationale ou internationale. Nommée le quatrième pouvoir, l’influence des médias sur la politique n’est plus à remettre en question. Le Watergate est un cas d’école en la matière : une enquête de presse de deux journalistes qui mènent à la démission sans précédent du président des États-Unis.
Le travail photojournalistique s’inscrit dans cette même dynamique et les exemples de la portée de clichés sur notre société sont variés. L’essai photographique de la journaliste Lee Miller « BELIEVE IT » ayant permis au monde entier de découvrir l’horreur innommable de l’holocauste en est un premier. Incapable de décrire l’atrocité des camps de concentration avec des mots, Miller a partagé ses clichés effroyables pour convaincre les sceptiques de la réalité de la guerre en Europe. Elle a permis de rendre réelles ce que l’Occident pensait encore n’être que des allégations propagandistes. L’importance de ses photos est d’autant plus grande aujourd’hui qu’elles permettent d’effectuer un travail de mémoire essentiel, ravivant l’inhumanité de l’histoire de la Seconde Guerre mondiale ainsi que l’impératif de ne pas laisser l’impensable se reproduire.
« La petite fille brûlée au napalm » est un autre cas de référence. Le 11 juin 1972, le New York Times publie ce cliché de Nick Ut montrant une enfant nue, terrorisée et brûlée au troisième degré au napalm dans un village vietnamien sous attaques américaines. Récompensée par le prix Pulitzer l’année d’après, la « Napalm Girl » marque tous les esprits et devient rapidement le symbole d’un sentiment anti-guerre aux États-Unis. Cette photo fera basculer l’opinion publique lors de la guerre du Vietnam, accélérant par la suite la défaite des États-Unis. Par ailleurs, l’histoire raconte que Nixon lui-même aurait émis l’hypothèse que la photo n’était qu’une mise en scène propagandiste anti-américaine.
L’impact de ces photos sur la scène politique met en lumière les capacités d’aide humanitaire des photojournalistes. Néanmoins, pouvons-nous pour autant dire que cela est suffisant pour justifier la surmédiatisation de certaines photos déshumanisantes? Est né dans les années 90 un mouvement qui a remis en question les supposées valeurs humanistes des photojournalistes. L’ouvrage du sociologue Luc Boltanski La souffrance à distance a soulevé cette question. Le manque d’éthique dans la démarche individualiste des photojournalistes à toujours vouloir chercher la photo la plus choquante est pointé du doigt. Il remet également en question les enjeux de la diffusion de ces clichés en argumentant que l’omniprésence de la souffrance dans les médias entraîne une lassitude dans les réactions du public face à ces photos et, in fine, limite leur portée dans l’aide humanitaire.
Cette opinion est également partagée par l’anthropologue Bernard Hours dans son livre L’idéologie humanitaire ou le spectacle de l’altérité perdue. Il en vient à juger que ces photographies choquantes ne sont pas l’apparat d’une solidarité bienveillante, mais celles d’une manifestation d’un voyeurisme occidental. Selon lui, cette pratique photographique ne servirait qu’à réconforter les pays du nord par comparaison de leurs problèmes avec la misère des autres. En effet, ces clichés à destination du public occidental représentent majoritairement des espaces chaotiques, dépourvus de toutes capacités économiques et sociales. Ils perpétuent alors cette image de l’hémisphère Sud comme un espace sous-développé et en attente d’être secourus par l’occident.
Ces discours ont remis en question le travail de beaucoup de photojournalistes et sont notamment derrière la tragique descente aux enfers du photojournaliste Kevin Carter. En 1994, Carter reçoit le Prix Pulitzer pour son cliché d’une enfant soudanaise en sous-alimentation extrême, affaissée sur le sol et semblant être la proie d’un vautour prêt à se jeter sur elle. Si la photographie de la fillette et le vautour devient l’icône de la famine en Afrique, une controverse éclate sur la responsabilité morale du photojournaliste. Pourquoi ne lui a-t-il pas prêté assistance? Kevin Carter, qui reconnaît avoir mis 20 minutes avant de chasser le vautour, est alors présenté comme « un prédateur, un vautour de plus sur les lieux ». Outre la capture du cliché lui-même, les critiques reprennent également le discours de Bernard Hours sur le regard que pose la photo sur l’Afrique. Seule avec le rapace, l’image véhicule implicitement que la fillette est livrée à elle-même et que la population locale est dépourvue de tout moyen. Or, des témoignages nous apprennent quelques années après que la tante de l’enfant la surveillait en faisant la queue dans un centre d’approvisionnement alimentaire. Les critiques continuent de fuser quand Kevin Carter se donne la mort pendant l’été 1994 : le poids de la culpabilité était-il trop grand?
Cette histoire illustre le dilemme photojournalistique. Le contexte de la fillette et le vautour met en lumière le problème de chercher à choquer au détriment, s’il le faut, de l’éthique. Néanmoins, c’est précisément le côté choquant de cette photo qui a permis d’alerter sur la crise alimentaire en Afrique, bien réelle à ce moment-là. Le regard moralement inconfortable que l’on porte sur l’état de santé de l’enfant, similaire à bien d’autres, renferme un potentiel d’actions majeures au même titre que les photos de Lee Miller et Nick Ut. La photo a d’ailleurs été utilisée dans le cadre d’une campagne de financement au profit de la fondation Save the Children. Dans ce cas, Kevin Carter a-t-il fait plus de bien ou de mal? Là est la complexité du travail photojournalistique : la photo doit être choquante pour avoir un impact, mais choquer revient à adopter parfois des méthodes immorales. Où se trouve la limite?
Ce débat, toujours d’actualité, est animé par les perceptions et les opinions de chaque individu et il est impossible de fournir une réponse universelle. Ces dernières années, certains éléments sont toutefois apparus pour guider les photojournalistes. À travers le monde, les associations journalistiques ont posé des codes d’éthique que chaque journaliste se doit de respecter dans son travail. On y retrouve notamment l’obligation de donner le contexte de la photo et d’éviter de stéréotyper les individus et les groupes. Un autre point très répandu est le devoir de traiter tous les sujets avec dignité et de ne s’immiscer dans les moments privés que lorsque cela est justifié. Si sur le papier ces codes de déontologie donnent une première réponse, leur application reste plus compliquée. Comment juger si une situation est justifiable? Alors que certains préconisent l’utilitarisme, soupeser le poids des conséquences positives au regard des négatives, il est encore une fois impossible de donner une réponse universelle. L’éthique du photojournalisme contient alors beaucoup de questionnements et très peu de réponses pour un sujet qui peut donner naissance au meilleur comme au pire.
Édité par Jo-Esther Abou Haidar
Camille (she/her) is in her third year at McGill, majoring in Political Science and International Development Studies. As it is her first year working with Catalyst, she is thrilled to fulfill her new role of french writer and work with the team. Her areas of interest encompass humanitarian assistance, disaster relief, and the repercussions of climate change on populations.